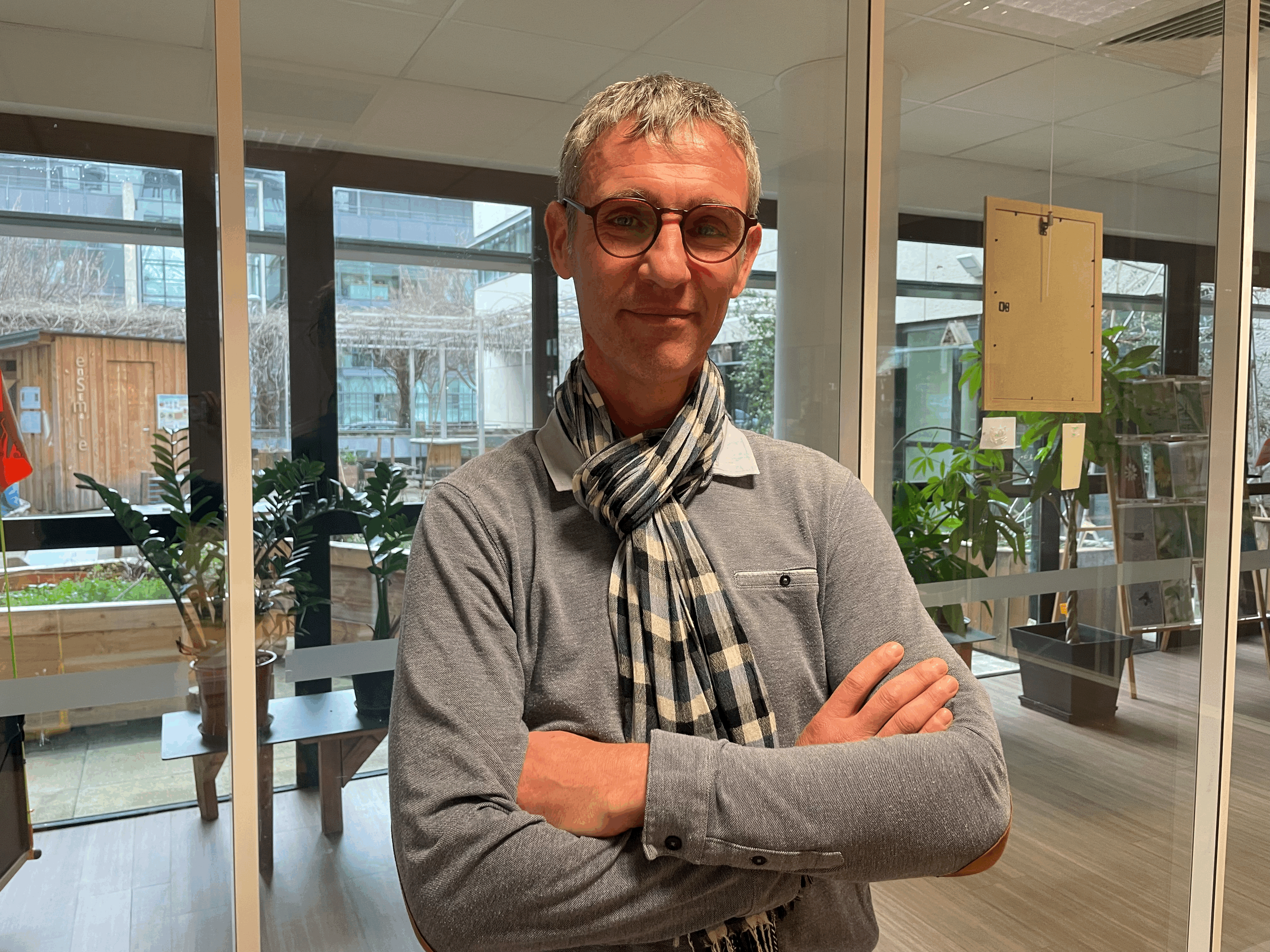7 janv. 2026
Olivier Erard : « L’être humain peut se transformer, mais il doit arrêter d’être feignant ! »
Par
Florence Gault
À Métabief, dans le Doubs, la station de ski a acté en 2020 la fin du ski alpin d’ici 2030-2035, face aux effets du changement climatique. Après cinq années de réflexion, cette décision marque un tournant pour cette station de moyenne montagne. À l’origine de cette transition : Philippe Alpy, président du Syndicat mixte du Mont d’Or, et Olivier Erard, alors directeur de la station. Ce glaciologue de formation, autrefois défenseur de la neige artificielle, revient dans Le passeur (Editions Inverse) sur cette transformation et sur son propre cheminement, entre convictions, doutes et prise de conscience.
©En un battement d'aile
Comment décririez-vous l’identité du territoire de Métabief, façonnée à la fois par la montagne, le ski et les traditions locales ?
Métabief est un territoire de moyenne montagne, situé à 800 mètres d’altitude, dont le sommet Moron est à 1400 mètres. On est à la frontière suisse, à trois quarts d'heure de Lausanne. À l'époque, on l'appelait la petite Sibérie française.
J'aime analyser l'identité d'un territoire par les fêtes qu'on y organise, ce qui fait vivre ce territoire. Quand vous regardez les fêtes, c'est les comices agricoles et les compétitions de ski de fond. Et on a l'agriculture avec le comté, bien sûr ! C’est un territoire de ski de fond, beaucoup plus que le ski alpin, même si à l'origine, c'est le ski alpin qui a amené l'économie.
En 2016, se pose la question du remplacement des remontées mécaniques qui nécessite un investissement de 15 millions d'euros du conseil départemental. Ces remontées datent des années 80, elles s’usent anormalement et ont des soucis de stabilité et de sécurité. Et vous vous demandez si vous avez 20 ans de neige devant vous pour amortir cet investissement financier ?
On a pu constater qu’en s’appuyant sur des données météo historiques et les modélisations climatiques comme ClimSnow, que même avec la neige de culture, certaines zones allaient devenir difficilement exploitables. On risquait d'avoir un hiver sur deux sans neige en dessous de 1000 mètres. Et ce, bien avant 2030.
Alors, est-ce qu’on continue d’investir dans de nouvelles infrastructures, ou est-ce qu’on adopte une autre approche ? En 2017, on a donc pris la décision de ne pas investir dans ces nouveaux équipements, car le problème ne se poserait pas dans dix ou vingt ans, mais dès maintenant.
On s’est dit qu’on aurait l’air bien malin avec des remontées mécaniques flambant neuves et une exploitation fermée un hiver sur deux.
À lire aussi | Les stations de ski face au défi du dérèglement climatique
Et à la place, vous faites le choix de la maintenance…
Ce n’était pas évident, car dans un secteur aussi réglementé que le transport public, la sécurité est primordiale. Si des vibrations trop importantes sont détectées, le ministère des Transports peut exiger l’arrêt de l’exploitation. À l’époque, on ne comprenait pas précisément l’origine de ces vibrations, mais on a développé une méthode analytique basée sur la macrosismique, qui nous a permis d’identifier le problème : il venait des massifs en béton. Plutôt que de changer les remontées, on a donc rénové ces massifs, en capitalisant sur le savoir-faire interne qu’on avait développé ces dernières années.
Cette approche va à l’encontre du modèle dominant dans l’industrie, qui repose sur le renouvellement systématique des équipements. Mais on a prouvé qu’en misant sur l’entretien et l’optimisation de l’existant, on pouvait continuer à exploiter les infrastructures en toute sécurité, sans tomber dans une logique de surinvestissement qui n’aurait pas été viable face au changement climatique.
Quand prenez-vous la décision d’annoncer la fin du ski alpin à l’horizon 2030-2035 ?
À partir de mi-2018, on a dû faire face à une réalité : on renonçait à un programme d’investissement sur lequel on avait déjà communiqué, qui avait sans doute suscité des attentes chez les socio-professionnels et donné de l’espoir à certains. À l’origine, on était dans une logique simple : on investit dans la neige de culture, on rénove les remontées mécaniques défectueuses, et on continue. Sauf que là, on marque un coup d’arrêt. On entrait dans ce qu’on appelle un renoncement. Mais comment l’annoncer ? Car il y a aussi la manière dont on raconte les choses.
On ne peut pas juste dire : « Voilà, le ski, c’est fini. » Il faut amener l’idée progressivement, la faire entrer dans les esprits.
C’est une stratégie de communication, on applique les mêmes règles que dans le marketing classique. On sait très bien que les systèmes aujourd’hui ne sont pas entièrement vertueux. Ils fonctionnent avec des leviers de pouvoir, d’influence. On s’est souvent posé la question : est-ce qu’on manipule ou est-ce qu’on influence ? Et en réalité, c’est permanent. Oui, on manipule. Oui, on joue avec les médias. Parce qu’on en a besoin.
Comment a réagi la population ?
Il n’y a pas eu de réaction du côté des habitants. On les a un peu leurrés jusqu’à l’année dernière. Ce n’est qu’après la parution du livre et la fermeture de la station que les habitants ont vraiment pris conscience de la situation. Avant ça, le sujet était resté flou pour eux. Il faut comprendre que si on avait décidé d’être totalement transparents dès le départ, en réunissant tout le monde autour d’une table, en demandant l’avis de la population sur chaque étape, on n’aurait jamais avancé.
Et du côté des élus, quelle a été la réaction ?
La première fois que j’ai présenté un graphique aux élus, qui montrait clairement la baisse des températures et son impact sur le chiffre d’affaires, ça a été un choc. Certains ont refusé d’y croire : « Olivier, tu ne peux pas montrer ça. Ce n’est pas possible. » A force de travailler sur ces scénarios, fin 2018, c’est devenu une évidence : on devait intégrer l’idée de la fin du ski. Sauf qu’on n’avait pas de plan B. À ce moment-là, on m’a dit : « Olivier, toi qui es ingénieur, trouve-nous une solution. » Mais la réalité, c’est que personne n’avait de solution miracle. On a imaginé plein d’alternatives : tyroliennes, parcs d’attractions… Mais rien ne peut vraiment remplacer le ski. Et aujourd’hui, on travaille encore dessus.

Dans Le passeur, vous revenez sur le processus de transition engagé à Métabief. Quelles sont, selon vous, les clés essentielles pour accompagner un tel changement ?
La transition écologique repose sur une posture clé du leader : celle d'accepter l'incertitude et de permettre l’exploration. Cela peut sembler peu, mais c’est en réalité fondamental. Beaucoup ne le font pas. Il s’agit d’écouter, de reconnaître qu’on ne sait pas tout, de réfléchir et de se donner les moyens d’expérimenter sans savoir précisément où cela va mener. Avec le recul, ce qui ressort comme le plus étonnant dans le processus, c’est justement cette ouverture. On anticipe en se donnant dix ans, on se dit qu’on a un peu de temps, et on accepte d’ouvrir une passe, de créer une marge pour réfléchir. On injecte des moyens, de l’ingénierie, de l’animation, sans forcément avoir une réponse immédiate.
L’objectif dans notre cas était clair : maintenir le ski le plus longtemps possible sans alourdir le modèle, pour éviter de le rendre encore plus vulnérable, tout en faisant émerger de nouvelles solutions. Accepter qu’il n’y a pas de solution unique est essentiel. Si on se limite à l’échelle du périmètre, on ne trouve pas de réponse évidente.
Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette transition ?
La première impulsion, c'était de laisser quelque chose à mes collègues et de se rappeler le chemin parcouru. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. J’ai un peu eu cette envie de laisser quelque chose en disant « et oui, ce qu'on a fait, c'est énorme ». Et mesurer les étapes qu'on a passées, on les a passées ensemble. Moi, la première chose que j'ai faite une fois que j'avais le manuscrit, je l'ai fait lire à mes collègues. Parce que tout ça, je l’ai vécu à travers mon prisme, mes souvenirs, mes émotions. Et quand ils m’ont fait leurs retours, je me suis dit que j'avais bien fait de le faire.
Et puis, j'ai quand même la conviction que c'est la méthode pour changer le monde. Finalement, les solutions sont à aller chercher, au plus près du terrain. C'est-à-dire au plus près de ceux qui ont le plus à perdre. Et c'est ce rôle du passeur entre ceux sur le terrain et les décisionnaires, il est fondamental.
Vous avez désormais quitté Métabief. Que vous reste-t-il de cette expérience ?
Beaucoup de joie et beaucoup d’émotions (Il pleure). Je me suis laissé embarquer. Quand on est dans des situations difficiles, c’est là que le collectif prend tout son sens, qu’il gagne en maturité. J’avais un véritable sentiment de redevabilité. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Ce n’est pas de la prétention, mais je me suis dit : s’il y en a un qui doit le faire, c’est moi. Parce que chacun joue sa partition, et c’était la mienne.
Ce que je retiens de tout ça, c’est que malgré tout, il faut croire en l’humain. Il est capable de se transformer ou, au minimum, d’arrêter d’être feignant. On a tout pour y arriver, mais notre cerveau est programmé pour l’économie d’énergie. Il trouve mille raisons de ne pas changer.