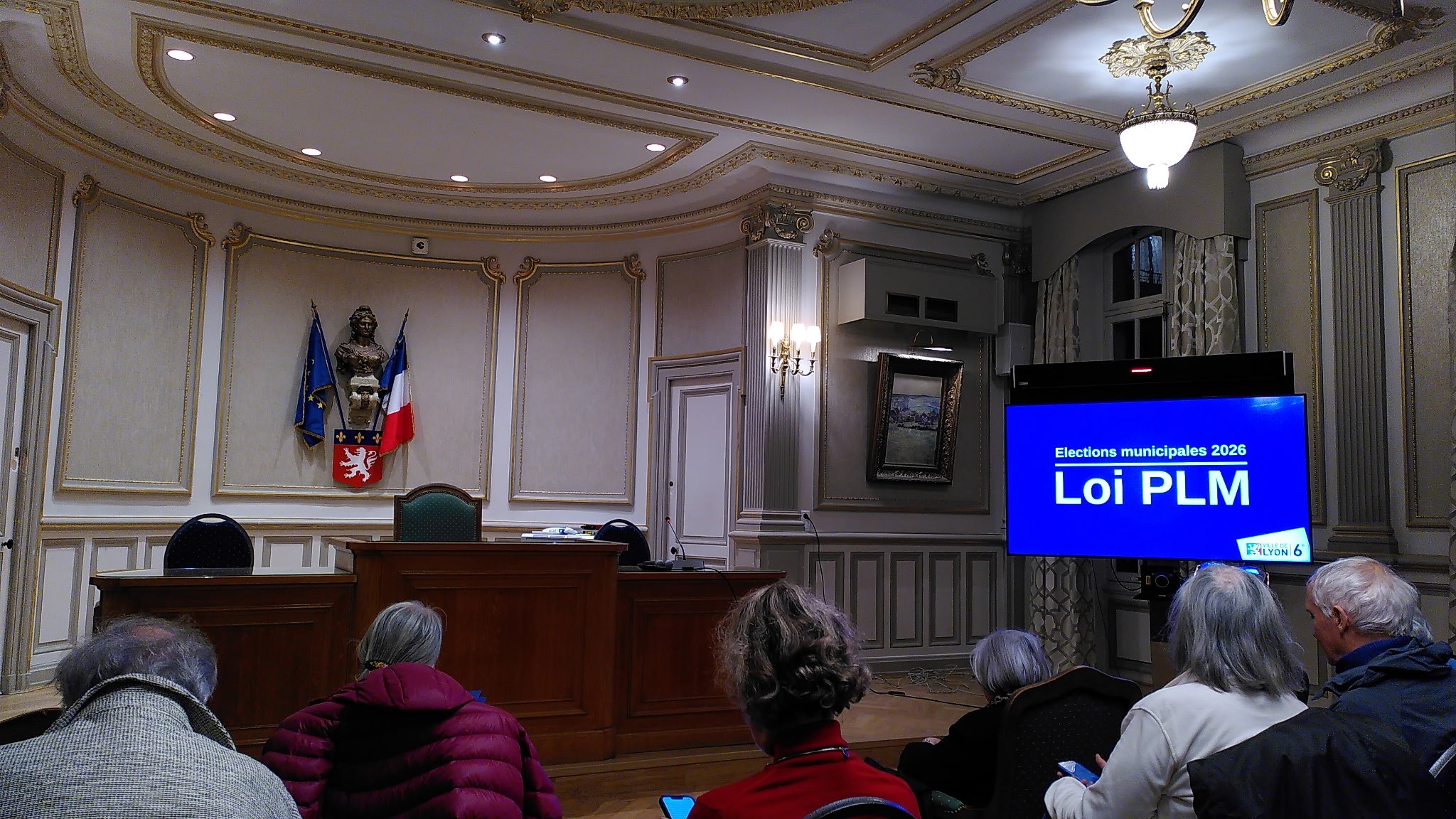13 août 2025
Marie Gatesoupe, médiatrice numérique et militante du partage
Par
Sika Kodo
Marie Gatesoupe a quitté le monde du graphisme pour devenir médiatrice numérique au Centre social Bonnefoi, à Lyon. Engagée sur les questions de genre, d’accessibilité et d’inclusion, elle accompagne aujourd’hui des publics fragilisés dans leur apprentissage du numérique. Dans ce nouvel épisode de la série Les portraits de l’été – La série qui donne envie de bifurquer, elle revient sur ce changement de vie, les valeurs qui l’animent et la manière dont elle met son expérience au service d’une transformation sociale concrète.
©En un battement d'aile
Vous avez travaillé plusieurs années comme graphiste avant de rejoindre le Centre Bonnefoi. Pouvez-vous nous raconter ce parcours en quelques grandes étapes, et surtout nous dire ce que vous faites concrètement aujourd'hui au centre ?
J’ai été graphiste 3D à partir de 20 ans, pendant une dizaine d’années, avec deux ou trois expériences principales. Puis j’ai décidé de changer de voie. Après une période de reconversion et d’exploration, j’ai trouvé ce poste de conseillère numérique, ou médiatrice numérique, au Centre social Bonnefoi. Mon objectif principal est de lutter contre la fracture numérique dans les quartiers Moncey, Voltaire, Guillotière. Pour cela, je propose des ateliers à petits groupes d’environ cinq personnes, adaptés à leur niveau, pour leur apprendre à utiliser l’informatique et les outils numériques au sens large, comme les smartphones ou les tablettes.
À quel moment vous êtes-vous dit que ce que vous faisiez ne vous correspondait plus ?
L’envie de changer s’est faite vraiment petit à petit. Dans l’évolution de ma carrière, j’ai eu la chance de monter en compétences et d’accéder à des postes de management. J’aimais les défis techniques, la gestion d’équipe. Mais petit à petit, j’ai ressenti une lassitude, une impression de « faire le tour ». Ce n’était plus cohérent de passer autant de temps dans un travail qui me mettait beaucoup de pression, avec toujours des délais très courts. Je me suis dit que je ne faisais que des images, et que ce n’était peut-être pas normal de me sentir acculée régulièrement. En plus, je ne me reconnaissais plus dans le fait de pousser des équipes. Cela ne correspondait plus à mes valeurs.
Aviez-vous déjà une fibre écologique avant cela ?
Je pense que c’était plutôt latent. Plutôt une envie de justice sociale déjà, et forcément l’écologie en fait partie.
Votre travail ne se limite pas à la médiation numérique. Vous êtes aussi engagée sur les questions de genre, pourquoi cet engagement vous tient-il à cœur ? Comment vous abordez ces sujets avec les publics que vous accompagnez ?
Mes engagements militants, je les porte au quotidien dans mon métier mais surtout à travers les associations dont je suis bénévole, comme Antillais, Les Arpenteurs Urbaines, et le collectif La Dewey. Ces actions me tiennent à cœur parce que ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’écart entre les personnes.
J’ai découvert le féminisme grâce à des podcasts féministes. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte à quel point ça me mettait en colère. Et j'avais envie d'agir pour essayer de porter un nouveau regard et une nouvelle parole dans mon quotidien. J'ai essayé de chercher des associations et des endroits d'engagement et c'est là où j'ai rencontré différents collectifs.
Quels retours avez-vous sur vos interventions ?
Les retours sont divers, car je touche des publics variés selon les associations. Avec Les Arpenteurs Urbaines, on agit contre les violences de genre dans l’espace public, en aidant à faire émerger des initiatives féministes. Avec La Dewey, on organise un festival en mixité choisie pour réapproprier des savoir-faire techniques, notamment auprès de personnes qui n’y ont pas accès.
Dans mon travail au centre social, mes ateliers rassemblent majoritairement des femmes, car ce sont elles qui fréquentent le plus les centres sociaux. Le numérique devient une passerelle pour parler d’autres sujets, notamment liés au genre.
Changer de voie ne se fait pas en un claquement de doigts. Quel a été le plus gros obstacle au début et comment l’avez-vous surmonté ?
Le plus gros problème, c’était le jour où je me suis dit « j’en ai marre, je veux partir, mais je ne sais pas quoi faire après ». J’ai eu la chance d’organiser mon départ avec mon employeur, mais la vraie question était : qu’est-ce que je vais faire ? Je n’avais jamais pris le temps de réfléchir à autre chose.
Ce qui m’a aidée, c’est un bilan de compétences. La conseillère m’a orientée vers le milieu associatif, en me suggérant de faire du bénévolat pour découvrir ce qui me correspondait.
J’ai commencé à pousser la porte d’associations, ce qui a créé un appel d’air.
Qu’est-ce que vous avez gardé ou transformé de votre ancienne vie professionnelle pour nourrir ce que vous faites aujourd’hui ?
J’ai gardé mon ordinateur, c’est un peu drôle. Un des premiers trucs que je me suis dit en quittant le graphisme, c’était que je ne voulais plus parler à un ordinateur mais être devant des gens. Apparemment, je fais les deux maintenant, tant mieux.
Mes compétences en informatique m’ont suivi. Le bilan de compétences m’a aussi permis de réaliser que j’avais beaucoup à apporter de mon expérience en gestion de projet. Ce travail de gestion d’équipe, c’est précieux en animation de groupe : créer un cadre de confiance, une bonne ambiance, tout en transmettant des savoirs pour que les gens puissent ensuite s’émanciper.
Avec du recul, qu’est-ce que cette transition vous a appris sur vous-même ? Quel conseil donneriez-vous à une personne hésitant à se reconvertir ?
Cette transition m’a donné beaucoup de confiance en moi. En plus du bilan de compétences, je me suis formée un an au sein de l’Institut de transition, à Lyon. Ça a été un moment très important, un tremplin pour me légitimer, apprendre à défendre mes idées et rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes problématiques.
Cela me permet de faire partie d’un écosystème où il y a des personnes qui me ressemblent, mais pas seulement. En tout cas, cela offre un soutien au quotidien, ce qui fait que l’on se dit : si on fait la lumière au bout du tunnel, elle existe vraiment, et il faut la suivre.
D’ailleurs, cette métaphore de la lumière au bout du tunnel serait sans doute le conseil que je donnerais à ceux qui hésitent. À mon avis, quand on hésite, c’est qu’on a déjà, au fond, une vraie envie. Bien sûr, il peut y avoir de nombreux freins : la peur des difficultés financières, des obstacles liés à l’entourage, au lieu où l’on vit, à la situation personnelle.
Pourtant, si on a les moyens de se lancer, cette hésitation est souvent un signe qu’on a réellement envie de changer. Et ce n’est pas grave de ne pas savoir tout de suite ce que l’on veut faire. Moi, il m’a fallu une année pour quitter mon entreprise, avec un bilan de compétences, de nombreux autres accompagnements, ainsi que le soutien de mes proches et des discussions. Cela a été un long chemin avant de me décider.