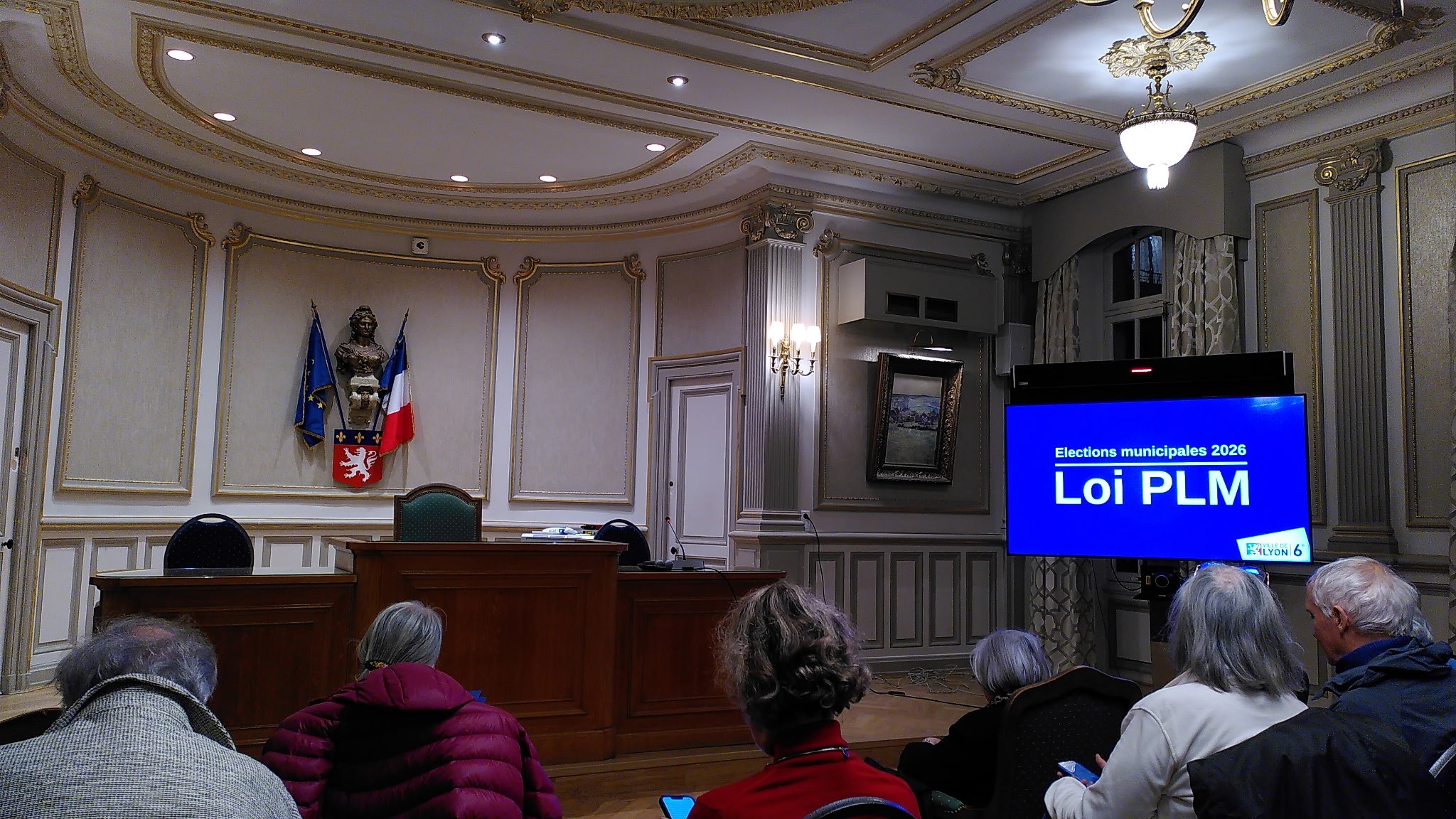14 oct. 2025
“Arrêtez de parler de climat pour changer les comportements" : entretien avec le sociologue du climat Stéphane La Branche
Par
Aurélie Chanier et Florence Gault
« Le nœud du problème, il est humain » : pour Stéphane La Branche, sociologue du climat, la transition écologique ne se résume pas à une question technique ou économique. Dans cet entretien, il plaide pour une véritable transition humaine et civilisationnelle, fondée sur nos pratiques quotidiennes, nos choix collectifs et nos récits communs.
©DR
Et si la transition écologique était d’abord une affaire humaine ? C’est la conviction de Stéphane La Branche, sociologue du climat et coordinateur scientifique de l’Alliance pour le GIECO (Groupe International d’Experts sur les Changements de Comportements). Il explore depuis vingt ans les liens entre comportements, émotions et représentations collectives face à la crise. Pour lui, la transition ne se résume pas à une équation technique ou économique : elle doit devenir un véritable projet de société. Dans cet entretien, il revient sur son parcours et partage des pistes concrètes, de l’alimentation aux politiques publiques, pour accompagner ce basculement.
Nous sommes installés dans votre dojo pour cet entretien. Peut-on y voir un lien symbolique avec notre manière d’être combatif face à la crise écologique ?
Stéphane La Branche : Oui, en partie. Parce qu’en fait, c’est un dojo de MMA, où on pratique la boxe, de la lutte, du sol, avec et sans les coups. Et donc, c’est un sport très stratégique et très complexe. Ce qui veut dire que parfois, il faut céder, parfois il faut rentrer dans le tas. Parfois il faut attendre son moment.
Donc, il y a toute une stratégie qui est applicable à la transition écologique : choisir le bon moment pour faire la bonne chose. Cela étant dit, un deuxième parallèle, c’est que faire la bonne chose au bon moment suppose qu’on comprend ce qu’il faut faire, et à quel moment le faire.
Pour filer la métaphore, dans un combat comme dans la transition écologique, l’essentiel n’est-il pas de rester debout ?
SLB : Le KO, il va être civilisationnel. Donc il faut tenter de l’éviter. Une partie de mes motivations personnelles, c’est d’éviter le KO, ou même une dérive fasciste quelconque. On a eu tendance en France - mais c’est vrai dans les autres pays aussi - à faire, au début, de la politique publique coercitive, obligatoire, même quand ce n’est pas nécessaire. C’est complètement contre-productif.
Toute la question, c’est : par rapport à nos phases de vie, nos valeurs, à la diversité de notre population, quel type de politique publique mettre en œuvre pour que ce soit le plus efficace possible ?
Vous êtes l’un des pionniers de la sociologie du climat en France. Ce champ était encore peu connu il y a 20 ans. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la sociologie du climat ?
SLB : C'est la discipline qui s'intéresse aux différents facteurs, telles que les représentations sociales, les valeurs, mais aussi le contexte dans lequel on vit, l'urbanisme, les politiques publiques, et qui analyse comment cela entre en interaction avec nous, individus, et la transition.
Et, ces interactions vont dans les deux sens. Les interactions sont parfois congruentes, c'est-à-dire que l'envie des gens peut aller dans le sens de la transition, parfois contre la transition. On peut aussi trouver de l'indifférence. La sociologie tente de comprendre tout cela, dans sa complexité.
Je trouve que le terme « transition écologique » est à côté de la plaque. Il faut parler de transition humaine. On va régler la crise écologique si et seulement si on change nos modes de vie. Et pour aller un peu plus loin, c’est même une transition de civilisation.
À lire aussi | Écologie et fêtes de famille : comment éviter les tensions à Noël ?
Parler de transition civilisationnelle, ce n’est pas un mot un peu fort ? Cela ne risque-t-il pas d’effrayer ?
SLB : Moi, je fais vraiment une sociologie du quotidien, des pratiques. Et ce que je constate, c’est que les gens ne rentrent pas autant qu’ils le devraient dans les efforts de transition, non pas par rejet idéologique, mais à cause du quotidien. C’est le fait d’avoir un deuxième enfant, de vivre dans une ville sans transports en commun, de manquer de temps à cause du travail. Ce sont toutes ces petites contraintes de la vie ordinaire, mises bout à bout, qui rendent le changement difficile.
Je commence de plus en plus à penser et à dire qu'il est faux de parler d'obstacles au changement comme si c'était un barrage ou un mur et qu’on ne peut plus avancer. Ce qui nous empêche de changer, ce sont des forces très dynamiques et très actives, comme l’est le système capitaliste et consumériste.
« Le nœud du problème, il est humain. Donc les solutions potentielles sont aussi humaines. Ce n’est pas aux molécules dans l’atmosphère de changer de comportement. »
Vous êtes coordinateur scientifique du GIECO, créé en 2020 par un groupe d’experts sur les changements de comportement. Quel est son rôle ?
SLB : Dans les sciences sociales, on a tendance à garder nos résultats pour nous-mêmes. Et pour moi, il y avait une nécessité fondamentale à se parler entre nos disciplines. L’idée derrière le GIECO, c’est non seulement d’avoir différentes disciplines dans un même rapport, mais aussi dans un seul chapitre sur une thématique spécifique.
Il faut comprendre que sur la question écologique, le nœud du problème est humain. Donc les solutions potentielles sont aussi humaines. Ce n’est pas aux molécules dans l’atmosphère de changer de comportement.
Le GIECO a publié en juillet 2025 son premier rapport. Que révèle-t-il sur les conditions qui permettent, ou non, un changement de comportement ?
SLB : Face à l'éco-anxiété, on peut être soit bloquer, soit on peut avoir envie de bouger. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Il y a quelques hypothèses qui sont ressorties. Un premier élément, transversal, c’est que la pédagogie et la psychologie infantile en matière d’environnement montrent que des contacts directs, sensibles, à l’enfance — avec le corps, le goût, les carottes qu’on mange, grimper dans un arbre — sont un facteur important. Ce n’est pas un intérêt cognitif, mais une sensibilité.
Le deuxième, c’est ce qu’on appelle la self-efficacy (NDLR : auto-efficacité). C’est-à-dire la perception que j’ai de ma capacité à agir, et de ma capacité à avoir un effet sur le réel. Or, dans le domaine environnemental, l’impact individuel est peu visible : seul, on ne change pas grand-chose, c’est l’effort collectif qui compte. Certains ont besoin de voir les résultats pour agir, d’autres se satisfont du simple fait d’agir — une motivation dite intrinsèque, qui caractérise, selon moi, une grande partie des écologistes.
Un troisième facteur, moins souvent évoqué, est le perfectionnisme. Beaucoup renoncent si une solution n’est pas parfaite, mais accepter des solutions partielles qui apportent un petit gain permet malgré tout d’avancer.
Au final, deux éléments influencent la manière dont les gens réagissent face à l’urgence écologique : la perception de sa propre capacité à agir, motivée intrinsèquement ou extrinsèquement, et le contact avec la nature dans l’enfance. La psychologie montre que, face à l’angoisse, le simple fait de passer à l’action la diminue, même si le problème reste entier.
Y a-t-il des aspects que le rapport laisse encore ouverts, des éléments qui mériteraient d’être creusés davantage ?
SLB : Il y a une émotion souvent négligée : l’amour du vivant. Avec Dominique Bourg, nous en avons discuté : la peur et l’anxiété sont étudiées, mais les émotions positives envers la nature existent aussi, et elles sont importantes. Quand on explore le profil des écologistes, cette dimension revient toujours. Pour moi, c’est un moteur très puissant, même si la civilisation ne lui accorde pas encore beaucoup d’attention.
Arrêtez de parler de climat pour changer les comportements ! Ça ne marche pas. Et arrêtez de parler du rapport du GIEC. Ça ne marche pas non plus !
On a dressé un état des lieux. Mais si l’on regarde les solutions possibles, quels sont les leviers concrets de mise en mouvement ?
SLB : Le premier, c’est de réduire l’effort cognitif que cela prend. Par exemple, le fait de réaliser une rénovation énergétique du bâtiment ne change rien aux comportements qui sont dedans, mais ça réduit beaucoup l'énergie consommée.
Deuxième chose : arrêtez de parler de climat pour changer les comportements ! Ça ne marche pas. Et arrêtez de parler du rapport du GIEC. Ça ne marche pas non plus ! Vous voulez convaincre vos amis de manger moins de viande ? Vous pouvez leur donner un livre entier sur les méfaits de la viande, écologiques, santé, économiques, biodiversité… Ou, vous leur faites un bon plat végétarien et vous leur donnez la recette !
Il faut imaginer des co-bénéfices, sans même devoir mentionner l’environnement. Pas forcément financiers ; mais des co-bénéfices qui vont dans le sens de l’être humain.